De Jérusalem à la Gaule : que s’est-il passé entre l’an 33 et Clovis (496) ?
Comment une petite secte juive née à Jérusalem a-t-elle conquis l’Empire romain avant de s’imposer en Gaule ? De Jésus à Clovis, plonge dans les origines politiques et religieuses du christianisme.
Mort de Jésus (vers l’an 30-33)
Jésus est crucifié par les Romains sous Ponce Pilate, probablement entre l’an 30 et 33 selon les historiens du Nouveau Testament [1].
À ce moment-là, il n’y a pas encore de « christianisme », seulement une secte juive messianique issue du judaïsme palestinien [2].
Les apôtres poursuivent sa prédication, mais ce sont surtout les lettres de Paul (rédigées entre 50 et 60) qui diffusent l’idée d’un messie universel [3].
Le tournant stratégique : Paul de Tarse
Paul, citoyen romain d’origine juive, ouvre le message de Jésus aux non-Juifs (les « Gentils »). Il voyage à travers l’Empire (Asie Mineure, Grèce, Rome) pour fonder des communautés chrétiennes [4].
Il abandonne certaines lois juives (comme la circoncision) pour rendre la foi plus accessible [5]. → Le christianisme se détache du judaïsme et devient une religion à vocation universelle.
Les persécutions romaines (Ier au IIIe siècle)
Les Romains tolèrent initialement le judaïsme, mais perçoivent les chrétiens comme des dissidents dangereux refusant le culte impérial.
Sous Néron (64), puis Domitien, Dèce, et Dioclétien, les chrétiens sont persécutés : arrestations, exécutions publiques, interdiction de réunion [6].
Malgré cela, le message chrétien touche surtout les milieux pauvres, esclaves et femmes, sensibles à la promesse d’égalité dans l’au-delà [7].
Le coup de théâtre : Constantin (IVe siècle)
En 313, l’édit de Milan signé par Constantin et Licinius proclame la liberté de culte dans l’Empire [8].
En 325, le Concile de Nicée réunit 300 évêques pour établir les fondements de la foi chrétienne : la Trinité, la divinité du Christ, le Credo de Nicée [9].
En 380, sous Théodose Ier, le christianisme devient la religion officielle avec l’édit de Thessalonique. Le paganisme est désormais interdit [10].
En moins de 70 ans, le christianisme passe du statut de secte persécutée à celui de religion d’État impériale, avec une hiérarchie, des dogmes, et l’appui militaire de Rome.
On passe donc d’un petit mouvement minoritaire… à une religion officielle, soutenue par l’État, avec églises, évêques, dogmes et hérésies.
Et en Gaule ?
La Gaule romaine devient une terre de christianisation progressive à partir du IIe siècle.
Des évêques sont établis à Lyon (Irénée), Arles, Marseille… Ces villes deviennent des relais d’évangélisation [11].
Des martyrs comme Sainte Blandine (morte en 177) sont exécutés pour leur foi [12].
Mais l’Église reste marginale jusqu’à la chute de Rome.
Clovis (vers 496) ne fait que « légaliser » ce qui est déjà bien en place
Clovis, roi païen des Francs, épouse Clotilde, princesse catholique burgonde.
Après sa victoire à la bataille de Tolbiac (496 ?), il se convertit avec 3000 guerriers et est baptisé à Reims par l’évêque Remi [13].
C’est l’acte fondateur de la monarchie chrétienne française — qui prendra dès lors le titre de « fille aînée de l’Église » [14].
Sources académiques et historiques
- John P. Meier, Un certain Juif, Jésus. Les données de l’histoire, éd. du Cerf, 2001
- Bart D. Ehrman, Christianismes anciens, HarperOne, 2003
- Paul (apôtre), Épîtres pauliniennes, Nouveau Testament
- Étienne Trocmé, L’évangélisation de l’Empire romain, Payot, 1991
- Hans Küng, Le christianisme, son essence et son histoire, Seuil, 1999
- Paul Veyne, Quand notre monde est devenu chrétien, Albin Michel, 2007
- Rodney Stark, The Rise of Christianity, HarperSanFrancisco, 1996
- Édit de Milan, texte intégral dans Corpus Inscriptionum Latinarum
- Concile de Nicée I, Actes conciliaires, trad. française par G. Bardy
- Édit de Thessalonique (Codex Theodosianus, XVI.1.2)
- Michel Rouche, Clovis : de la Gaule païenne à la France chrétienne, Fayard, 1996
- Grégoire de Tours, Histoire des Francs, VIe siècle
- Jean-François Kahn, Histoire de la France, Perrin, 2015
- Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’Église, Tome II, Seuil, 1956
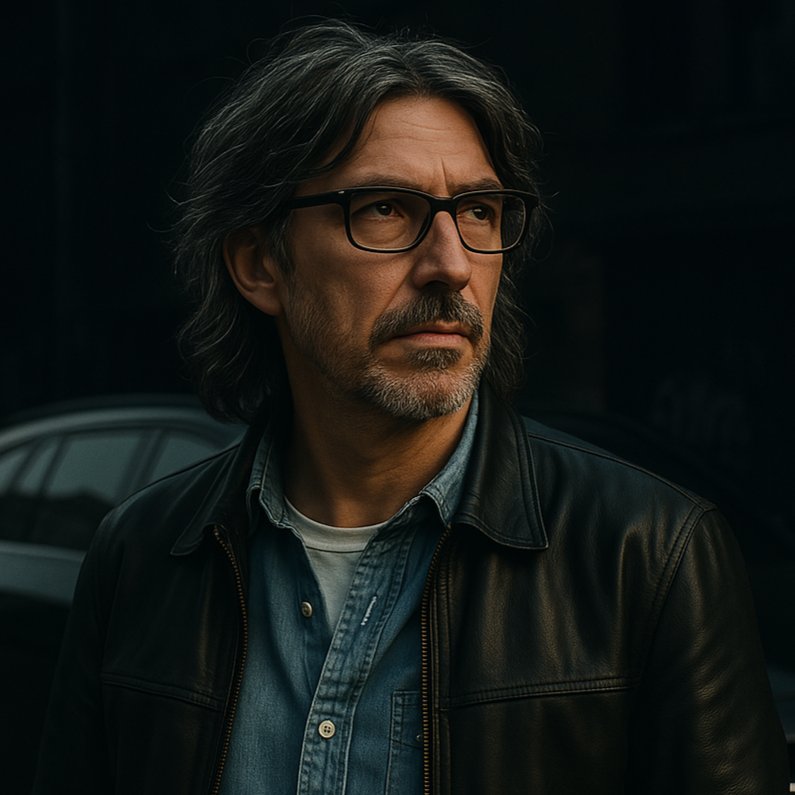
Le 9 juin 2025
À lire aussi sur informative.be
Votre Média Belge pour comprendre les enjeux de notre société.
📂 Christianisme, Croyances et Religions, Histoires
🏷️ Manipulation, Religions
 Acheter du Bitcoin avec N26
Acheter du Bitcoin avec N26