Molenbeek : chronique d’un naufrage belge
Molenbeek n’est pas devenu islamiste par hasard. Immigration mal gérée, ghettoïsation, salafisme et laxisme politique : retour sur 40 ans d’aveuglement belge.

Partie 1 — De l’immigration ouvrière au bastion islamiste
De la main-d’œuvre au communautarisme
Dans les années 60, la Belgique signe des accords avec plusieurs pays pour importer de la main-d’œuvre bon marché. Parmi eux : le Maroc (1964), la Turquie, la Tunisie.
Les premiers arrivants sont souvent des hommes seuls, venus travailler dans les mines, la sidérurgie ou le nettoyage urbain. Le quartier de Molenbeek, proche du canal et des usines, devient un point d’arrivée pratique et peu coûteux.
Mais l’État belge ne prévoit rien d’autre que le travail.
Pas de programme d’intégration, pas de politique culturelle, pas d’encadrement linguistique.
Les travailleurs immigrés deviennent vite des familles immigrées. Et Molenbeek devient un ghetto ethnique, au fil des décennies.
Ghettoïsation et abandon
Dans les années 80-90, les Belges « de souche » désertent progressivement le quartier.
Les écoles se communautarisent, les commerces aussi. Les femmes se voilent, puis se recloîtrent. Les services sociaux et l’État reculent.
Ce n’est plus l’immigration : c’est la séparation silencieuse.
Molenbeek devient un territoire à part, un quartier où l’on vit dans une autre langue, une autre culture, une autre vision du monde.
L’infiltration salafiste dans les années 90
C’est à ce moment-là que les premiers réseaux salafistes s’implantent.
Des prédicateurs formés en Arabie saoudite, en Syrie ou au Pakistan commencent à diffuser un islam ultra-rigoriste, antisioniste, anti-occidental, anti-femmes.
Et ils trouvent un terrain fertile :
- Des jeunes en échec scolaire,
- Des familles coupées de la société belge,
- Des mosquées mal encadrées,
- Des autorités locales qui ferment les yeux par idéologie ou par clientélisme.
Des réfugiés aux profils ambigus
Dans les années 90, la Belgique accueille aussi des réfugiés politiques venant d’Irak, d’Algérie, de Tchétchénie ou de Bosnie.
Si beaucoup fuient des régimes violents, certains importent leur idéologie avec eux.
Des anciens membres du GIA algérien, des sympathisants de Ben Laden, ou des islamistes fréristes s’installent tranquillement à Bruxelles.
Ils tiennent des librairies islamiques, dirigent des associations, infiltrent des mosquées…
Et tout cela sans que personne ne réagisse.
Une génération livrée à Internet
Dans les années 2000, Internet change la donne.
YouTube, forums, Facebook deviennent les nouveaux lieux de prêche.
On n’a plus besoin d’un imam radical : il suffit d’un téléphone et d’un algorithme bien orienté.
À Molenbeek, des jeunes désœuvrés tombent dans les discours :
- du salafisme puriste,
- du djihadisme pro-Daesh,
- du rejet total de l’Occident, des juifs, des femmes, des gays.
Et l’État dans tout ça ?
Il regarde ailleurs.
- Par peur de “stigmatiser”,
- Par laxisme judiciaire,
- Par idéologie multiculturaliste,
- Ou par pur clientélisme électoral : ne pas froisser “la communauté”, c’est garder les voix.
Molenbeek devient une zone hors radar, jusqu’au jour où l’Europe découvre, horrifiée, que les terroristes de Paris venaient… de Belgique.
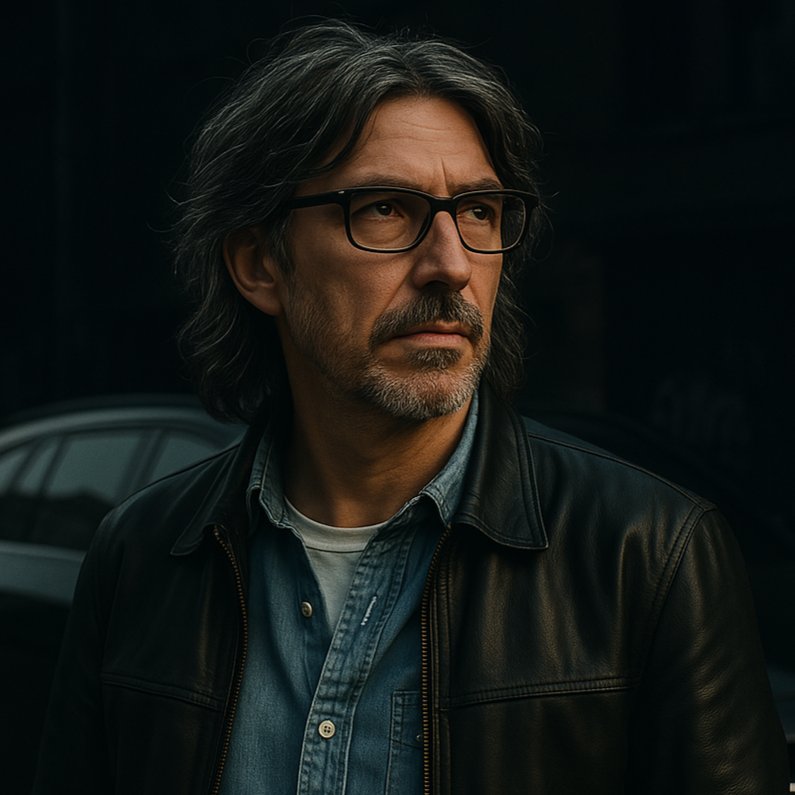
Le 20 juillet 2025
À lire aussi sur informative.be
Votre Média Belge pour comprendre les enjeux de notre société.
 Acheter du Bitcoin avec N26
Acheter du Bitcoin avec N26