Le racisme en Belgique : un mal enraciné dans l’histoire
Derrière l’image d’un pays ouvert, la Belgique cache une histoire longue de rejets, d’humiliations et de silences. Le racisme y est un héritage, pas un accident.

La Belgique aime se voir comme un pays tolérant, multiculturel, ouvert.
Et pourtant, un rapport récent des Nations Unies vient briser cette illusion : le racisme y est profond, structurel, enraciné dans l’histoire.
Il ne se limite pas à quelques insultes ou à des extrêmes marginaux.
Il se niche dans l’école, l’emploi, la police, le logement — et surtout, dans une mémoire collective sélective.
Comprendre le racisme en Belgique, c’est remonter à ses racines.
Un passé colonial oublié… ou volontairement effacé
- 1885-1908 : L’État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold II, devient un laboratoire de domination raciale.
Travail forcé, mutilations, massacres : plusieurs millions de morts. - 1908-1960 : Le Congo belge poursuit cette logique coloniale sous l’étiquette « civilisatrice ».
On enseignait aux missionnaires et administrateurs que le Noir était « un grand enfant à éduquer », inférieur par nature.
L’immigration économique et le rejet social
- 1950-1980 : La Belgique fait appel à la main-d’œuvre étrangère (Italiens, Espagnols, Polonais, Marocains, Turcs).
- Ils viennent pour travailler, mais sont cantonnés aux tâches pénibles, mal logés, discriminés.
À Tongres, dans une discothèque appelée Le Real, une pancarte affichait encore : “Interdit aux Italiens.” jusqu’en 1999.
Et ce n’était pas un cas isolé : ce racisme assumé existait à Liège, Bruxelles, Charleroi…
On tolérait les bras, pas les visages.
Racisme structurel : quand ce n’est plus un « dérapage »
Le racisme belge ne se limite pas à des propos de comptoir.
Il est institutionnel :
- CV jetés à cause du prénom,
- Contrôles de police ciblés,
- Orientation scolaire biaisée,
- Barrières invisibles à l’emploi et au logement.
En 2024, un groupe d’experts de l’ONU conclut :
“La Belgique souffre d’un racisme systémique dans tous les secteurs.”
Et pourtant : aucune reconnaissance officielle. Aucune stratégie nationale.
Les mécanismes ne changent pas, les visages oui
Chaque génération de migrants a connu les mêmes phases :
- On les appelle pour combler une pénurie.
- On les parque, on les sous-paye, on les stigmatise.
- On les accuse de « ne pas vouloir s’intégrer ».
- Et quand ils réussissent, on les oublie.
Les Italiens hier.
Les Maghrébins aujourd’hui.
Les Subsahariens et les réfugiés demain.
Le racisme belge est cyclique, jamais guéri, juste déplacé.
Et maintenant ?
- Les discriminations sont moins visibles, mais tout aussi présentes.
- Les jeunes Belges issus de l’immigration se sentent toujours étrangers, même nés ici.
- L’extrême droite avance, masquée par des mots comme « culture », « sécurité », « identité ».
- Et les tabous historiques restent intacts.
On accuse les autres de communautarisme,
mais la plus grande communauté fermée, c’est souvent la société majoritaire.
Conclusion
Le racisme en Belgique ne vient pas du peuple.
Il vient de l’histoire.
De ce qu’on refuse de voir, de nommer, de réparer.Le nier, c’est prolonger l’injustice.
Le reconnaître, ce n’est pas s’accuser. C’est enfin pouvoir avancer.
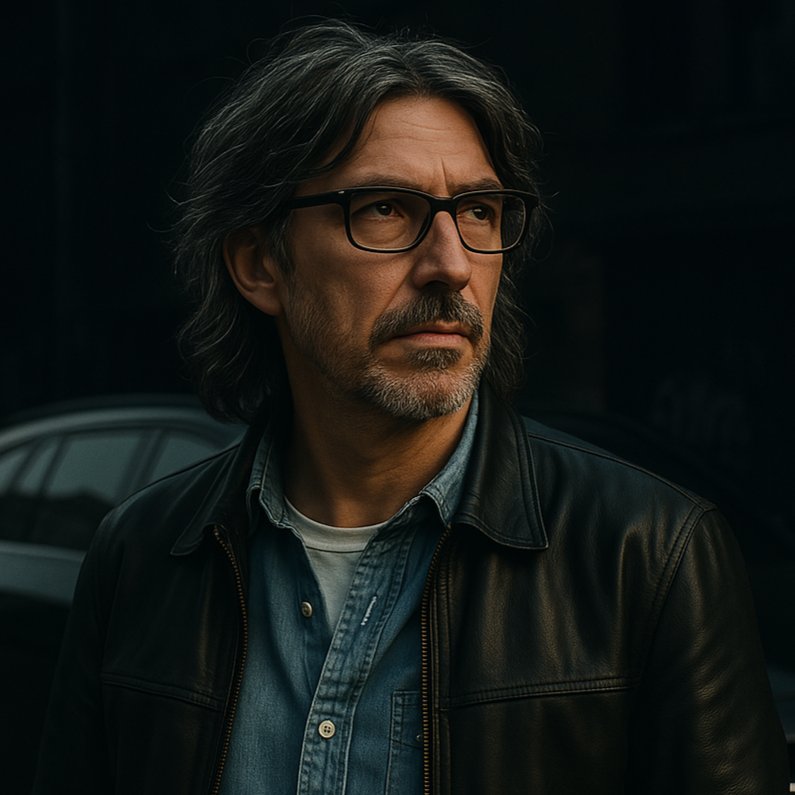
Le 13 juin 2025
À lire aussi sur informative.be
Votre Média Belge pour comprendre les enjeux de notre société.
📂 Histoires, Racisme et Discriminations, Société
🏷️ Discrimination, Racisme
 Acheter du Bitcoin avec N26
Acheter du Bitcoin avec N26