Quand le storytelling politique devient un tic : le cas Magnette et la communication
Le tic du « j’ai rencontré quelqu’un hier » de Magnette illustre le storytelling politique. Entre émotion, tics de langage et perception de biais médiatique, décryptage des stratégies PS, PTB, MR et N-VA.

Lors des débats politiques, un détail attire de plus en plus l’attention : certains responsables, comme Paul Magnette (PS), semblent toujours avoir « rencontré quelqu’un hier » qui illustre parfaitement le sujet du jour. Derrière cette petite phrase répétée se cache une stratégie de communication bien rodée : transformer la politique en récit émotionnel. Mais quand le procédé devient trop visible, cela interroge sur son authenticité… et sur le rôle des médias qui relaient ce discours.
Le storytelling : une arme politique efficace
En politique, les chiffres frappent moins que les histoires. Dire « un Belge sur cinq vit sous le seuil de pauvreté » paraît abstrait. Mais raconter : « J’ai croisé une mère célibataire qui doit choisir entre nourrir ses enfants ou chauffer sa maison » touche directement l’auditeur.
Ce procédé, utilisé par Magnette et d’autres, vise trois objectifs :
- Humaniser le discours et créer de la proximité.
- Simplifier le débat en incarnant les problèmes dans des visages connus.
- Déplacer la discussion vers l’émotion plutôt que la rationalité.
Le registre émotionnel de la gauche
Le PS et surtout le PTB ont fait de ce storytelling une arme centrale.
- PS : Magnette incarne une posture de professeur à l’écoute, ponctuée d’anecdotes sociales.
- PTB : Hedebouw ou D’Haese poussent encore plus loin, avec un langage direct, presque militant, toujours centré sur « le travailleur » ou « la voisine » rencontrée.
Objectif : court-circuiter l’analyse rationnelle et parler directement au cœur de l’électeur. Un discours émotionnel mobilise plus facilement qu’une démonstration technocratique.
Les tics de langage récurrents en politique belge
Au-delà du storytelling, certains automatismes reviennent sans cesse dans les débats :
- « J’ai rencontré quelqu’un hier… » (PS/PTB) → incarnation émotionnelle.
- « Les gens n’en peuvent plus » (tous partis) → généralisation floue mais mobilisatrice.
- « Soyons sérieux » / « Objectivement… » (MR/N-VA) → posture rationnelle, mais parfois perçue comme arrogante.
- « C’est la faute de… » (tous partis) → bouc émissaire commode.
- « Moi je parle vrai » (PTB, MR, N-VA) → auto-proclamation d’authenticité, parfois contradictoire quand tout le monde l’utilise.
La perception de biais médiatique
À cela s’ajoute la manière dont les médias traitent les responsables politiques.
- Certains reprochent à Martin Buxant (RTL) d’être plus indulgent avec Magnette qu’avec Bouchez. Avec le président du MR, les questions sont souvent critiques et les interruptions fréquentes. Avec Magnette, le ton paraît plus bienveillant.
- Cette impression alimente l’idée que les médias francophones penchent davantage à gauche (PS, PTB), tandis que les libéraux et nationalistes (MR, N-VA) seraient traités plus durement.
- À l’inverse, en Flandre, De Wever bénéficie souvent d’une écoute respectueuse, alors que les socialistes y sont challengés plus frontalement.
Conclusion
Le tic du « j’ai rencontré quelqu’un hier » n’est pas qu’une manie de Magnette : c’est le symbole d’une communication politique moderne centrée sur l’émotion. Si cette technique est efficace pour capter l’attention, elle peut aussi lasser, voire décrédibiliser, lorsqu’elle devient trop visible.
Combinée à une perception de partialité médiatique, elle contribue à renforcer la méfiance des citoyens envers le débat politique.
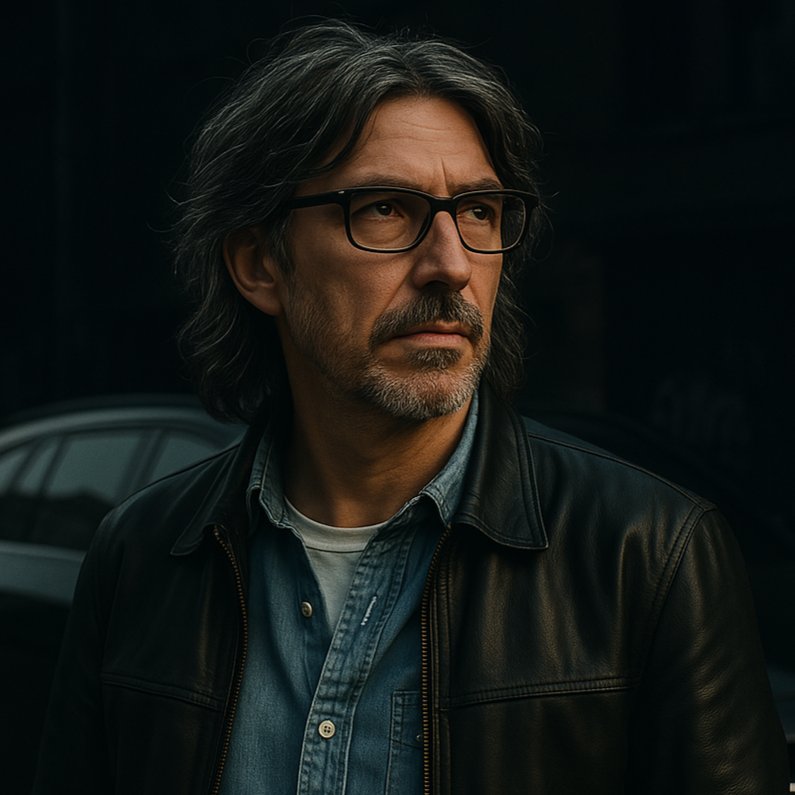
Le 8 septembre 2025
À lire aussi sur informative.be
Votre Média Belge pour comprendre les enjeux de notre société.
